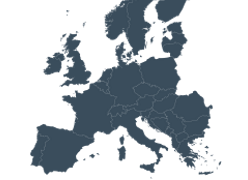Article publié sur le site www.atlantico.fr le 29 juillet 2015 : lien
L’agriculture française sous la pression du porc allemand
Le bras de fer entre agriculteurs, industriels de la transformation, groupes de la grande distribution et gouvernement s’éternise, notamment car les acteurs précités n’ont pas de réel pouvoir sur la fixation des prix. A terme, ce combat est même nuisible pour l’industrie agro-alimentaire.
La fixation des prix des matières premières n’est pas décrétée par le gouvernement, l’agriculture ne fait pas exception. Comme pour le pétrole, les prix dépendent du contexte international : s’agissant de l’élevage, on peut mentionner l’embargo russe, la consommation chinoise et l’offre des principaux producteurs, dans notre cas l’Allemagne et l’Espagne. En effet, outre le fait que la Russie a renouvelé son embargo sur la production agroalimentaire européenne, l’Allemagne et l’Espagne imposent une rude concurrence à nos éleveurs. Il faut se rendre compte qu’en quinze ans la production de porc de ces deux pays a quasiment doublé et que, déjà à l’époque, on parlait de surproduction. L’Allemagne, en particulier, a fait de son agriculture une industrie automatisée, à la pointe de la technologie, qui repose sur des élevages à forte concentration pour obtenir un rendement deux fois supérieur à la France, et ce en dépit d’un traitement animal critiquable.
Autre facteur justifiant cette productivité à toute épreuve, les abattoirs outre-Rhin ont « délocalisé chez eux » en faisant le choix de compter sur des travailleurs d’Europe de l’est qui travaillent (déduction faite de l’hébergement, transport, etc.) pour moins de cinq euros de l’heure. Pourtant, depuis le 1er janvier 2015, l’Allemagne a accepté la généralisation du salaire minimum, mais son application fait débat. Les syndicats dénoncent les nombreuses pratiques des employeurs, particulièrement dans l’industrie de la viande, visant à se soustraire à la législation : heures supplémentaires non-rémunérées, facturation aux employés d’équipements indispensables pour leur travail, surfacturation des offres de logement pour compenser la hausse des salaires, etc. On comprend alors aisément pourquoi le porc allemand est 20% moins cher que le porc français.
Dès lors que les prix allemands sont inférieurs aux nôtres, pour une qualité similaire, on ne peut raisonnablement s’en prendre aux industriels de la transformation qui se fournissent sur le marché allemand. Ne pas le faire les mettrait en danger. Il faut prendre conscience que leurs concurrents européens sont pour la plupart déjà présents sur le marché français. Outre qu’ils perdraient des parts de marché, la baisse de leurs marges ne leurs laisserait plus que le choix entre la faillite, la délocalisation ou le rachat qui, à terme, mènerait vers une délocalisation. La distribution, elle, a fait le choix d’acheter, autant que faire ce peut, en France. Il est vrai que les agriculteurs n’y ont pas été de main morte pour faire pression sur ces acheteurs. Mais c’est le secteur de la transformation qui en souffre. En effet la distribution ne faisant quasiment pas de marge sur les produits d’élevage et ne pouvant agir sur celles des multinationales, elle se rattrape sur les produits des PME de la transformation. Nous rentrons donc dans un cycle pervers qui met en danger tout le secteur.
La situation des éleveurs français est aggravée par l’embargo russe qui frappe les porcs européens depuis février 2014, pour des raisons d’abord sanitaires, puis ouvertement politiques, dans le cadre de la crise ukrainienne. Aussi, la seule solution économique réelle et non court-termiste d’augmenter les prix de façon vertueuse et immédiate nécessite de négocier un accord de sortie de crise avec la Russie, qui d’ailleurs profite de l’embargo pour s’équiper elle aussi en « super ferme ».
Face au diktat du porc allemand, une seule solution : notre génie administratif
On ne peut bien sûr laisser les agriculteurs gérer cette crise seuls. Le gouvernement a débloqué de l’argent, mais c’est insuffisant face au retard d’investissement massif accumulé par la filière élevage française qui est paralysée par des dettes, notamment à cause de normes environnementales qui nécessitent des adaptations constantes. Le plan du gouvernement vise à soutenir l’investissement, certains prêchent alors en faveur d’un redimensionnement des exploitations françaises, à l’image de ce qui se fait en Allemagne. Pour autant, en développant des élevages à forte concentration, la situation de surproduction sera aggravée et les prix seront davantage tirés à la baisse. De plus, il faudrait rattraper nos voisins européens qui ont quasiment quinze ans d’avance sur nous, baisser les charges de façon massive et surtout adapter notre corpus législatif et les objectifs d’un nombre incalculable d’administrations et agences. Hélas, tout cela semble bien irréaliste.
Comparativement à la situation de la filière élevage à l’étranger, nous avons l’impression que nos éleveurs ont été transformés en fonctionnaires précaires. On leur demande de prendre à leur compte des missions d’utilité publique : assurer l’autosuffisance alimentaire d’une nation à la population croissante et qui a perdu la moitié de ses agriculteurs en vingt ans, le tout en fournissant des produits de qualité à petit prix. De surcroît, ils se doivent de répondre à des exigences sanitaires et environnementales élevées, de mettre en œuvre la traçabilité de leurs produits, etc. Mais à l’inverse de la fonction publique, tout cela doit être réalisé dans un contexte de forte concurrence internationale. Leur mode de revendication est d’ailleurs le même que celui des fonctionnaires ou des professions réglementées, quels autres secteurs iraient, in fine, demander une augmentation de salaires au gouvernement ? Nous avons une agriculture complétement corsetée par l’administration. L’exemple le plus flagrant, même si on ne peut lui dénier toute utilité, est celui de la Safer, organisme qui a un droit de préemption sur les terres agricoles. Un agriculteur peut être empêché de vendre ou d’acheter ses terres par cet organisme. Ce pouvoir exorbitant, comme l’on s’en doute, crée des injustices permanentes, dont sont le plus souvent victimes nos jeunes agriculteurs (ceux qui n’ont pas encore suffisamment d’amitiés au sein des syndicats agricoles et coopératives) qui sont les plus à même d’introduire des innovations voire des ruptures technologiques.
Administration démotivante, charges trop lourdes, establishment entravant… Ce constat pourrait être applicable à tous les secteurs de l’économie française et, sauf révolution, risque de perdurer. Aussi, face à l’urgence, soyons réaliste : ajoutons quelques-unes de nos contraintes administratives à nos voisins, profitons tant qu’il en est encore temps de notre main d’œuvre « abondante » (pour un pays développé) et créons une rupture technologique.
Lors d’une manifestation, un agriculteur posait une question simple : « Pourquoi un litre d’Evian est vendu 35 cts et un litre de lait 29 cts » ? La réponse l’est tout autant : le marketing. Nos éleveurs ont la capacité de sortir d’une production bas de gamme où la concurrence est particulièrement rude. Ils ont encore un vrai savoir-faire qui pourrait leur permettre de passer à une production moyen-haut de gamme, plus rentable et nécessitant plus de main d’œuvre qualifiée. L’enjeu est de faire reconnaître cette qualité au niveau européen, avec des labels de certification obligatoires. Le but ne serait pas d’empêcher que les transformateurs s’appuient sur une image française pour vendre du porc allemand, mais de les inciter à utiliser de la viande française pour vendre leurs produits plus chers. La rigueur du traitement allemand vis-à-vis de la Grèce pourrait être une opportunité. Beaucoup d’européens mêmes s’il étaient en accord avec les positions allemandes ont été choqués par la manière. La mise en place de cette certification serait une bonne occasion d’envoyer un message à nos amis outre-Rhin.
Ce type de législation contraignante ne pourra que favoriser nos agriculteurs pour qui la traçabilité est une seconde peau. De plus, nous avons déjà de réels atouts en termes de qualité d’élevage, il suffit de souligner par exemple que nos éleveurs, contrairement aux allemands, ne gavent pas leurs porcs d’antibiotiques et protègent ainsi les consommateurs. Il convient donc de développer une filière bio ou en tout cas d’agriculture raisonnée, l’objectif étant de positionner la France sur le haut de gamme. Nous avons cette chance d’en avoir déjà l’image au niveau mondial et de posséder les ressources humaines et technologiques pour atteindre ce but. Créons une marque France dans le secteur. Cela ne doit pas empêcher non plus les agriculteurs à se regrouper et à créer des « super fermes », mais pour ne pas nuire à l’image « France » il faut fermer l’accès aux investisseurs sans scrupules, un peu sur le modèle des pharmacies.
A cela on peut opposer deux arguments. D’abord que le haut de gamme constitue un marché de niche : certes, mais au niveau mondial, cela représente un marché conséquent. Ensuite, on peut être dérangé par l’idée qu’une agriculture haut de gamme délaisse une partie des consommateurs français aux revenus insuffisants. On pourrait alors dire, de façon cynique, qu’il vaut mieux acheter moins mais d’une meilleure qualité, et que, de toute façon, nous sommes et seront de plus en plus amenés à manger moins de produits d’élevage. C’est ici que nous devons imposer une rupture technologique et profiter que l’ « uberisation » dans ce secteur ne soit encore arrivée dans aucun pays. En ce sens, organisons les filières pour réduire les distances entre producteurs et consommateurs en France et donc soutenir les prix via les nouvelles technologies. Il faut permettre aux agriculteurs de s’associer au sein de nouvelles structures souples (les coopératives sont des organisations bien trop lourdes) qui seront par définition des véhicules non endettées. Mais également leurs donner un accès massif à la BPI et les laisser profiter de subventions régionales dédiées à la numérisation des entreprises (utilisation des services des sociétés numériques) pour commercialiser directement auprès du consommateur final. Soyons aussi européen et acceptons de laisser les parts de notre marché bas de gamme à nos voisins.
Actuellement, le gouvernement fait encore appel aux consommateurs afin qu’ils acceptent de payer plus cher. Mais Il faut aussi responsabiliser les collectivités en suggérant à l’Etat de les inciter à réaliser au moins 30% de leurs dépenses vers les PME, et d’imposer aux restaurants d’établissements publiques, comme les cantines scolaires, qu’elles mettent en ligne les besoins hebdomadaires (si possible journaliers) de leurs cantines et que les appels d’offre soient divisées au maximum (un pour les œufs, un pour la viande de porc…) et non consolidés afin que toute PME puisse y répondre. Plus les appels d’offre seront petits et sur des périodes courtes et plus les entreprises locales seront à même d’y répondre tout en respectant le droit communautaire. Ces besoins doivent être corrélés aux saisons et productions de la région. Certes, tout cela nécessitera plus de travail, mais nous avons, au sein des collectivités, largement assez de ressources humaines pour ce faire, surtout avec la fusion des régions. Nous avons des raisons de croire que chacun sera d’accord pour que certains fonctionnaires soient dédiés à ce type de missions qui permettra notamment à nos enfants de bien manger et de redécouvrir leurs terroirs. Enfin, la mise en place de labels européens certifiant la qualité de l’élevage nous permettra de contourner l’interdiction de la mention d’appellation d’origine géographique dans les Appels d’Offre.
Dernier point mais pas des moindre, cette crise de l’agriculture française est loin d’être dépassée à l’heure où se négocie un traité de libre-échange entre l’Union Européenne et les Etats-Unis. Il faut rapidement reprendre nos positions à l’international et nous renforcer au plan national. Sauf révolution, la France n’a d’autres choix en l’état de ses forces et faiblesses, à notre sens, que de créer et conforter une offre haut de gamme quitte même à laisser le bas de gamme à nos voisins.